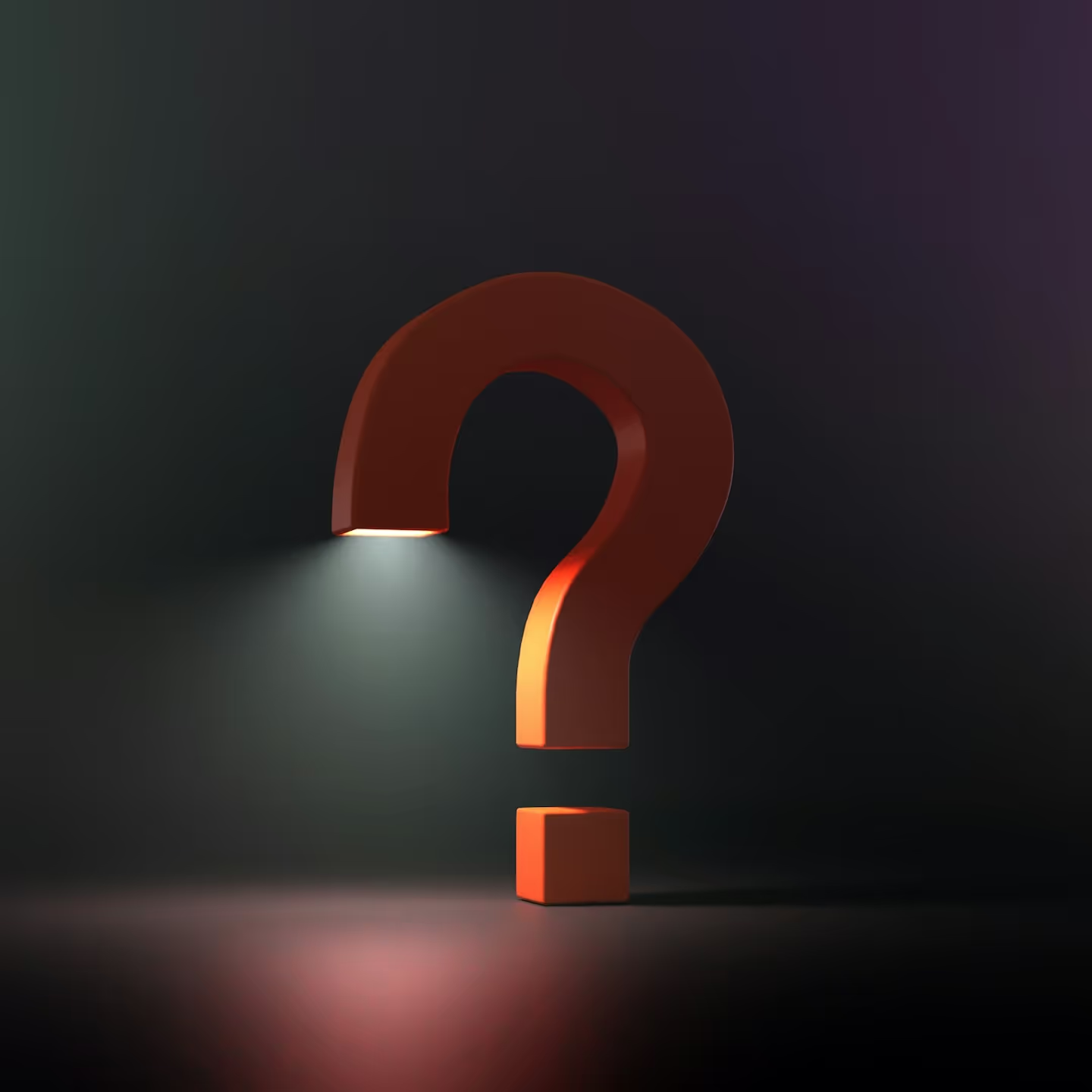Lorsqu’une victime subit une agression, des violences ou toute autre infraction pénale, elle peut obtenir une indemnisation même si l’auteur est inconnu, insolvable ou non poursuivi. Toute victime d'infraction peut, à certaines conditions, saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels et parfois matériels.
Comprendre les conditions de saisine de la CIVI, les délais, les documents à fournir et le rôle du FGTI (Fonds de garantie) permet d’éviter un rejet pour irrecevabilité et d’optimiser ses chances d’obtenir une réparation intégrale de ses préjudices.
Qu’est-ce que la CIVI ? Rôle, nature et fonctionnement
La CIVI est une juridiction civile spéciale présente auprès de chaque tribunal judiciaire. Bien qu’elle intervienne pour des infractions pénales, elle statue comme un juge civil, en appliquant les règles du Code de procédure pénale (articles 706-3 et suivants) et du Code de l’organisation judiciaire.
Elle est compétente pour :
- Vérifier si les conditions légales d’indemnisation sont réunies ;
- Examiner si les faits présentent le caractère matériel d'une infraction ;
- Fixer l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel ;
- Ordonner, si nécessaire, une expertise médicale ;
- Accorder des provisions à tout moment de la procédure.
Sa composition associe des magistrats professionnels et des personnes qualifiées connaissant les problématiques des victimes.
Compétence territoriale : quelle CIVI saisir ?
La victime peut saisir, au choix :
- La CIVI du ressort de son domicile,
- Ou celle de la juridiction pénale saisie.
Si la victime réside hors métropole et qu’aucune juridiction pénale n’est saisie en France, la compétence revient à la CIVI du tribunal judiciaire de Paris.
En cas de pluralité de victimes dans une même affaire, toutes peuvent saisir la même CIVI, même si elle n’est pas compétente normalement. Cela permet une gestion unifiée d'un dossier.
Les conditions d’accès à l’indemnisation : ce que la victime doit prouver
La CIVI n’indemnise pas toutes les infractions automatiquement. La victime doit démontrer que les faits ont le caractère matériel d'une infraction, indépendamment de l'identification et de la poursuite de l’auteur ou du résultat de la l'enquête pénale.
1. Indemnisation intégrale pour les atteintes graves à la personne
L’indemnisation est automatique lorsque la victime a subi :
- des violences ayant entraîné une ITT ≥ 30 jours,
- un handicap ou une incapacité permanente,
- une agression sexuelle ou un viol,
- Certaines infractions particulièrement grave.
Dans ces cas, l’indemnisation est intégrale, sans plafond.
2. Indemnisation plafonnée dans certains cas
Pour d’autres infractions, l’indemnisation existe mais est plafonnée, notamment pour :
- le vol,
- l’escroquerie,
- l’abus de confiance,
- l’extorsion,
- les destructions ou dégradations de biens,
- le chantage,
- les atteintes aux systèmes informatiques,
- la violation de domicile (régime nouveau).
Les conditions sont alors plus strictes :
- Indemnisation sous condition de ressources de la victime,
- Dommage entraînant une situation économique grave,
- Impossibilité d’être indemnisée autrement (assurances, recours civils…).
Ces dispositifs résultent des articles 706-14 à 706-14-3 modifiés par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023
Délais pour saisir la CIVI : 3 ans ou 1 an selon les cas
C’est l’un des points les plus importants, car le non-respect des délais entraîne la forclusion, c’est-à-dire le rejet automatique de la demande.
1. Délai de 3 ans à compter de l’infraction
La requête doit être déposée dans les 3 ans à partir de l'infraction.
2. Délai d’un an en cas de procédure pénale
Si des poursuites ont été engagées contre l’auteur, la victime dispose d’un délai d’1 an à compter de la décision pénale définitive (jugement ou arrêt ayant statué sur l’action publique ou civile).
Depuis la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, le délai d’un an court à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
3. Suspension pour les mineurs et majeurs protégés
Le délai ne court pas contre :
- les mineurs non émancipés,
- les personnes sous tutelle.
4. Relevé de forclusion
La CIVI peut relever la victime de la forclusion en cas :
- d’impossibilité absolue d’agir,
- d’aggravation du préjudice,
- ou de tout motif légitime.
Effet interruptif de l’aide juridictionnelle
La demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal interrompt le délai pour saisir la CIVI.
Cela permet à la victime de ne pas perdre ses droits pendant l’instruction du dossier d’AJ.
Comment saisir la CIVI ? La requête et les pièces à fournir
La saisine se fait par requête écrite, signée par la victime ou son avocat (la représentation par avocat n’est pas obligatoire mais fortement recommandée).
Elle doit contenir :
- l’identité de la victime ;
- le récit précis des faits ;
- la plainte déposée et toutes les pièces de la procédure pénales dont la victime dispose
- les certificats médicaux (CMI et certificat de consolidation) ;
- les justificatifs de revenus et d’incapacité ;
- toutes les pièces médicales, administratives et financières ;
- les justificatifs d’assurance ;
- pour les préjudices matériels : ressources, impossibilité d’être indemnisé, gravité de la situation.
La requête interrompt les délais de l’action en réparation.
La CIVI transmet ensuite le dossier :
- au procureur de la République,
- au FGTI (Fonds de garantie).
L'indemnisation par la solidarité nationale
Le FGTI (Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions) est l’organisme qui verse concrètement l’indemnisation aux victimes.
Comment est-il financé ?
Par une contribution obligatoire affectée aux contrats d’assurance (contribution attentats).
Chaque assuré contribue donc au financement de la solidarité nationale envers les victimes d’infractions.
Comment fonctionne-t-il ?
- La CIVI transmet le dossier au Fonds de Garantie.
- Le Fonds examine la demande et peut proposer une offre d’indemnisation.
- En cas d’accord, la victime est indemnisée sans attendre un jugement.
- En cas de désaccord, la CIVI tranche.
- Le Fonds exerce ensuite un recours contre l’auteur pour récupérer les sommes, sauf insolvabilité.
Ce mécanisme garantit une indemnisation rapide, même lorsque l’auteur est défaillant.
La faute de la victime : impact sur l’indemnisation devant la CIVI
La faute de la victime peut réduire ou exclure l’indemnisation si elle a un lien de causalité direct et certain avec le dommage. Contrairement à une idée répandue, la faute simple peut suffire, et aucune concomitance temporelle avec l’infraction n’est exigée.
Article 706-3 CPP : la faute peut réduire ou exclure l’indemnisation
L’article 706-3 permet l’indemnisation des atteintes graves (mort, incapacité permanente, ITT ≥ 1 mois, agressions sexuelles, traite des êtres humains…).
La faute de la victime peut lui être opposée soit pour réduire son droit à indemnisation, soit pour l'en exclure.
L'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que la réparation :« peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime », dès lors que cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Aucune exigence de faute volontaire ou de faute “très caractérisée”.
Aucune exigence de concomitance : la faute peut être antérieure si elle a concouru au dommage.
Jurisprudence
La Cour de cassation a par exemple admis l’exclusion ou la réduction dans des cas tels que :
- agresseur initial blessé mortellement lors de la riposte qu’il avait provoquée (exclusion) ;
- victime impliquée dans un trafic délictuel (ex. trafic de caméscopes, trafic de stupéfiants) se trouvant tuée dans le cadre du règlement de comptes ;
- implication de la victime dans des activités criminelles à l’origine du conflit.
Dans ces affaires, la faute de la victime était directement causale du dommage.
Sous l'article 706-3, la faute de la victime peut réduire ou exclure l’indemnisation dès lors qu’elle est causalement déterminante.
La commission n’est pas liée par la décision pénale (classement, relaxe…).
Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-10.647
La Cour de cassation retient que la faute de la victime directe, dès lors qu’elle présente un lien de causalité direct et certain avec le dommage, peut conduire à réduire ou exclure l’indemnisation, et précise également que cette faute est pleinement opposable aux ayants droit en cas de décès : les proches peuvent se voir opposer une exclusion ou une limitation de leur droit à réparation du fait de la faute de la victime décédée.
Cas où la CIVI refuse toute indemnisation
La CIVI ne peut indemniser que les dommages résultant d’un fait d’un tiers présentant le caractère matériel d’une infraction.
Ainsi, la CIVI refuse toute réparation lorsque :
- le dommage est auto-infligé (suicide, blessures volontaires) ;
- l’atteinte résulte uniquement d’un comportement personnel sans fait d'un tiers.
Besoin d’être indemnisé après une agression ou une infraction ?
Me Joris Caunes, avocat au Barreau de Paris en droit du dommage corporel et droit pénal, accompagne les victimes dans toutes leurs démarches devant la CIVI comme devant les juridictions pénales.
Sa maîtrise du droit du dommage corporel et des procédures d’indemnisation garantit une défense efficace et stratégique